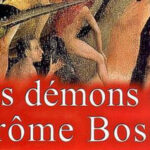« Un portrait par Giacometti » ou l’impossible accomplissement
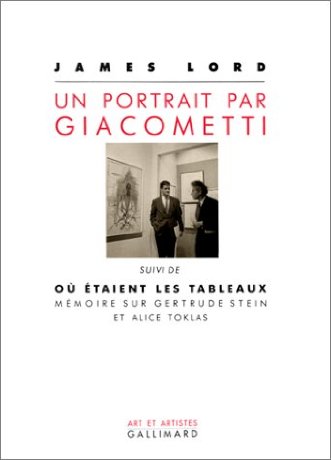 «En commençant à peindre, il me dit: «j’ai remarqué non seulement que, de face tu as l’air d’une brute, mais que ton profil est un peu dégénéré.» (…) Nous nous mîmes à rire tous les deux. Bien qu’il fut capable de plaisanter, il paraissait accablé par l’énormité de la tâche pas du tout drôle qu’il avait entreprise (…) Voilà trente ans que je perds mon temps, dit-il. La racine du nez me dépasse, je n’ai aucun espoir de jamais en venir à bout.» James Lord, Un portrait par Giacometti.
«En commençant à peindre, il me dit: «j’ai remarqué non seulement que, de face tu as l’air d’une brute, mais que ton profil est un peu dégénéré.» (…) Nous nous mîmes à rire tous les deux. Bien qu’il fut capable de plaisanter, il paraissait accablé par l’énormité de la tâche pas du tout drôle qu’il avait entreprise (…) Voilà trente ans que je perds mon temps, dit-il. La racine du nez me dépasse, je n’ai aucun espoir de jamais en venir à bout.» James Lord, Un portrait par Giacometti.
C’est Roy Andersson, le cinéaste suédois, qui m’a parlé de ce petit récit simple et rapide à lire et qui est pourtant l’un des plus justes que j’aie lu à propos de ce qu’est la difficulté de l’acte créatif, cet élan qui pousse certains à ressentir la nécessité de «donner un corps physique» à un ressenti abstrait, notre mystérieuse présence au monde.
Ce corps physique qui pourrait être un film ou une musique prend évidemment sous les mains d’Alberto Giacometti, fils de peintre et lui-même sculpteur et peintre, forme de dessin, peinture ou sculpture. Le récit évoque les 18 journées de travail passées dans son atelier du 14eme arrondissement à Paris, un été de 1964, et ne fait que décrire les gestes de Giacometti ainsi que les conversations qu’il a avec son modèle, James Lord qui les retranscrit avec un souci extrême d’objectivité, à propos du travail en cours ou d’autres artistes tels que Van Eyck, Matisse, Rembrandt etc…
Le récit prend place dans un décor quasi théâtral, une pièce qui sert d’atelier avec sa baie vitrée, son fouillis, ses outils, les oeuvres anciennes contre les murs, celles en cours sur des socles, et surtout le chevalet et la chaise du modèle. On a deux hommes face à face, unis par l’amitié, la conscience d’un temps partagé, unis aussi par la lutte de l’un pour tenter de mettre au monde sa vision de l’autre. Et bien sûr, on a le portrait qui, loin de jaillir, s’extrait (comme à la mine) lentement du néant par l’action du regard, des mains, des pinceaux, huiles, couleurs, et qui se donne à voir, s’efface, revient, passe par toutes sortes de transformations si minimes que c’en est presque comique, mais qui sont les résultantes des efforts désespérés de Giacometti pour retranscrire SA vision.
Comment restituer ce qui est si simple et si complexe, un visage, surtout depuis que la photographie existe ? «… il continua, travaillant obstinément jusqu’à ce qu’il fit presque nuit, concentrant toute son attention sur la tête. Quand il s’arrêta enfin et qu’on alluma, je vis que la tête était maintenant plus allongée et plus vague que la veille, couverte d’un lacis de lignes noires et grises et enveloppée d’une sorte de halo d’espace mal défini. Après la première séance de pose, il y avait eu un soupçon de ressemblance. A présente, il n’y en avait plus du tout.»
C’est le récit d’une lutte perdue d’avance, car les tentatives de Giacometti se heurtent sans cesse à son exigence et à son désespoir de ne pouvoir donner corps à l’image qu’il voit dans sa tête. C’est une bataille avec lui-même, entrecoupée de pauses cigarette, de repas d’œufs durs et de bols de café. Un récit sur la patience, l’impatience, le désespoir, l’espoir, la technique, les refus de la technique. « C’est impossible. Je ne sais rien faire. Ecoute, je vais travailler à cette toile un jour ou deux de plus, et alors, si elle ne vaut rien, je renoncerai à la peinture pour toujours ». Un récit sur la vanité d’entreprendre, et la joie du faire.
Chaque jour donc, Giacometti recommence, s’acharne. Le récit est si simple que l’on ressent physiquement avec Alberto et James le temps des sessions du travail, le passage du temps, la fatigue, l’énervante impossibilité de concrétiser une vision. 18 jours qui auraient pu devenir 20, 25, 50 si le modèle n’avait décidé de mettre un terme à la lutte, car le monde tourne malgré tout en dehors de l’atelier…
Là, je comprends pourquoi Roy Andersson aime tant ce récit, lui qui depuis des années conçoit et fait construire dans son studio de cinéma des répliques de lieux qui existent déjà, des rues de Stockholm, des parcs, des couloirs d’hôpitaux ou des bureaux de directeurs d’entreprise, des boutiques et des arrêts d’autobus, pour y faire jouer des scènes symboliques de sa vision de la société et du monde. Alors qu’il pourrait aller les filmer « en vrai », il tente de les faire exister tels qu’il les perçoit, avec leurs lumières, leurs ambiances étouffantes, un par un, éphémères car construits pendant des semaines pour être filmés quelques jours avant de disparaître pour laisser place à d’autres. C’est le même acte, la même geste désespérée de donner à voir ce que l’on ressent à l’intérieur, de tenter de maîtriser le plus précisément la matière pour lui faire transmettre l’idée juste.
Le livre de Lord est aussi une piste pour comprendre pourquoi un roman de Modiano n’est pas seulement un autre roman de Modiano, ou un buste de Giacometti un autre buste. Pour comprendre ce qu’est la création artistique sans passer par de grandes analyses savantes mais par une expérience physique, pratique même.
Pendant le temps du récit, le tableau passe par toutes sortes de transformations à peine notables et qui pourtant demandent au peintre et à son modèles beaucoup d’efforts et de cris. On est directement les mains dans la pâte, au cœur du ridicule mais essentiel acte de faire. « Pour continuer, pour espérer, pour croire qu’il a quelque chance de créer réellement ce qu’il se représente idéalement, il lui faut sentir qu’il doit en quelque sorte recommencer toute sa carrière, repartir à zéro chaque jour.» Et c’est pourquoi Giacometti laisse ses peintures inachevées, obligeant celui qui les regarde de faire le dernier effort, créant ainsi un lien entre l’artiste et son public, car malgré tout on agit pour se prouver qu’on existe mais aussi pour partager. «Une fois de plus, nous étions confrontés à l’impossibilité totale de ce que Giacometti tente de faire. Un semblant, une illusion est évidemment tout ce qui peut être atteint, et il le sait. Mais une illusion ne suffit pas. Et cette insuffisance lui devient de jour en jour moins acceptable, moins tolérable – presque physiquement – à mesure un peu plus loin, pas très loin, mais un peu plus loin, et au royaume de l’absolu «un peu» est sans limites.»