Itinéraire bis, une nouvelle

Gustave Fayet, la Route Mystérieuse, 1902, Pastel sur papier, collection privée.
La nouvelle Itinéraire bis a été écrite à la fin des années 90 et fait partie d’un ensemble de sept nouvelles nommé Itinéraires bis.

Itinéraire bis
Les pins défilent.
Un croisement, un choix, et à nouveau une route semblable à la précédente avec ce qui semble être les mêmes pins, les mêmes fermes aux volets foncés, isolées derrière leurs fortins de bois coupés, les mêmes lieux-dits vides, désertés par une humanité appauvrie par le Progrès.
Ils ne parlent pas; ils n’ont rien à se dire et commenter le paysage qui défile sans varier depuis des heures révélerait un humour dont ils sont dépourvus. La nuit va bientôt tomber et ils s’énervent chacun pour soi de ce détour dans la trajectoire si bien calculée de leur congé estival. Ils regardent les pins s’assombrir, les fermes allumer leurs télévisions bleues et sans qu’une âme qui vive n’apparaisse, des volets se ferment, du linge mis à sécher disparaît, des voitures se rangent à côté de leur domicile. Et pourtant ils n’ont croisé personne… A croire qu’on les évite, qu’on se cache d’eux. Ils ne se le disent pas mais chacun le pense, habitués comme ils sont à jouer de concert la musique de leur vie commune. Qu’on les évite ? Pensée saugrenue, presque comique, si par elle n’affleurait pas comme une note de désarroi. C’est sans doute la fatigue, la sensation vague d’être perdus, d’être passés et repassés plusieurs fois par les mêmes lieux. Et ce présent insolite, chacun, en soi, le repousse, sans pouvoir toutefois éviter que ne se dépose au fond de l’âme une poussiéreuse et sourde inquiétude.
– Non ! Je n’y crois pas !
Elle crie. Sa gorge sèche lui fait mal car elle n’avait plus parlé depuis des heures. Et pourtant si, voilà, ils sont en panne. Il tente une plaisanterie et elle entend vaguement qu’il s’agit de retour forcé au romantisme de leurs premières années ensemble, la nuit, la forêt, le mystère et eux deux… Mais elle est bien trop loin, bien trop enfoncée dans son propre moi pour qu’une miette de cette pauvre tentative d’apaiser la fatalité ne l’atteigne.
Chercher à qui la faute, se disputer au bord de la route qui de minute en minute s’assombrit. Ils ne feront pas ça. Les disputes aussi sont loin derrière. Alors ? Alors, ne pas se séparer, rester calme, chercher de l’aide… Abandonnant la voiture verrouillée avec soin, le coeur pratique, ils s’éloignent d’un pas alerte.
La voiture disparaît dans un tournant de la route qui les surprend comme les aurait surpris une colline aux Pays-Bas. Ils se demandent s’il était sage de s’aventurer ainsi. Hier encore, sur la terrasse familière, ils regardaient le soleil descendre derrière la haie en sirotant la certitude amère d’un verre pris chaque soir à la même heure et au même lieu. Cela leur parait étrangement lointain, étrangement fragile.
Des images de l’été écoulé envahissent leur conscience, nimbées de nostalgie vaine: la maisonnette en Pays Basque… la chambre fraîche aux rideaux neufs… la croissance inattendue d’un mimosa planté il y a dix ans… le fils arrivé impromptu qui s’est mis à repeindre les volets avec une bonne volonté excessive puis, mort d’ennui, est reparti, laissant les pinceaux sécher dans les pots… la fille qui téléphone chaque soir pour annoncer sa visite et n’est jamais venue. Bref, un été comme les autres depuis que les enfants ne partent plus en vacances avec eux et qu’ils ont cessé d’inviter des amis parce qu’il y a suffisamment d’obligations le reste de l’année.
Leur pas se fait las. Elle tâte la lampe de poche qu’elle a hâtivement cherchée et trouvée dans la boîte à gants. La petite lampe lui apporte le réconfort d’une lumière virtuelle, un peu comme lorsqu’étant enfant, lors des vacances passées chez sa grand-mère, elle gardait sous les draps une boîte d’allumettes car il fallait se lever pour atteindre l’interrupteur qui commandait l’unique lumière de la chambre…
Et toujours pas une âme. Pas de village non plus. Là où sur la carte fiévreusement consultée se trouvait un village, rien et encore rien que des pins. Et si un orage éclatait ?… Ne rien dramatiser… Ils ont bien déjeuné… Ce pull est un choix judicieux… Qu’est-ce que c’est que ce cri ?… Rien, voyons, rien… Un insecte maladroit la heurte de plein fouet… Quel dégoûtant contact !… Et ces pins, ces pins ! Toujours, toujours ces pins !
Ils marchent en silence, hantés par les ombres furtives de leurs inquiétudes.
Et puis soudain, comme surgie de nulle part, apparaît la silhouette massive d’une construction. La bâtisse est énorme. Ils s’étonnent de ne pas l’avoir remarquée plus tôt. Parce qu’elle est si bien enfouie dans les pins. Et parce qu’elle est plongée dans l’obscurité.
Tous deux ont l’idée que la maison est inhabitée mais qu’importe, cette trace humaine leur réchauffe le coeur. Ils quittent la route, prennent le chemin de gravier qui mène à la demeure.
Un mur de pierre. Un portail rouillé entrouvert. Puis brusquement, rendue visible par une forte rafale de vent qui écarte les branches des pins, brusquement de la lumière ! Ils regardent la demeure lourde et pourtant élégante, issue d’un autre siècle, l’escalier qui monte au perron, la balustrade massive mais ornementée. Tout respire l’art bourgeois et solide, construit pour durer. Ils montent l’escalier aux pierres usées par des générations, aux marches affaissées sous leur propre poids. Ils butent dans une masse douce et chaude: une petite fille.
Le regard est pénétrant. Elle n’a aucune crainte. Elle est chez elle. Ses cheveux clairs sont embroussaillés. Elle porte à peine rien et semble ne pas avoir froid. Elle les regarde sans étonnement, comme on regarde des inconnus pour déterminer leur nature ennemie ou pas.
Il veut parler mais reste muet. Elle veut sourire mais sent combien son sourire est déplacé. Elle dit: « Tu habites ici ? » La petite fille hoche la tête: un coup, sec, et le regard qui les transperce à nouveau: la robe d’été fleurie, le sac à main, les chaussures italiennes, la poche du pantalon de toile gonflée par le portefeuille, la fatigue, l’ennui, la peur… Elle semble avoir tout compris sur eux.
– Tes parents sont là ?
La petite fille détale.
Ils traversent le perron, attirés par la porte-fenêtre d’où provient la lumière. C’est celle d’un feu de bois immense qui flambe dans la cheminée et éclaire la pièce, une salle à manger du siècle dernier avec une grande table où dans un plat se fige la graisse d’un rôti. Devant le feu, un fauteuil assez profond pour dissimuler un géant.
– Il y a quelqu’un ?
Un visage apparaît de derrière le fauteuil, un homme encore jeune, dont le regard les atteint sans curiosité, simplement par politesse, pour répondre à leur appel. Le visage de la petite sauvageonne se penche par-dessus la tête de l’homme avec des yeux brillants et sûrs.
Ils expliquent la panne, la marche sur la route. Sans un mot, l’homme soulève la petite fille de ses genoux et la pose par terre. Sa robe rose très courte la fait ressembler à un bouton de fleur. L’homme tire un second fauteuil devant le feu, les invite à s’asseoir et sort de la pièce. La petite fille hésite puis part en courant derrière lui.
Ils s’assoient, louant en eux-mêmes la chance qui enfin leur a fait signe. Ils n’osent parler, intimidés par le silence de la demeure où seul le feu craque et gémit.
Soudain, ils se redressent. Une femme est sur le seuil. Elle tient par la main la petite fille rose, et ces figures féminines qui s’encadrent dans la porte semblent être les deux versions, à une échelle différente, du même modèle: chevelure claire en bataille, corps robuste un peu massif, visage statuesque aux contours fins et aux traits forts. La version grande taille, la femme, leur souhaite la bienvenue. Elle a une voix sourde et mélodieuse, et une manière brusque et plaisante de jeter les mots par poignées comme on sèmerait un champ.
L’homme revient avec un plateau où des verres, une bouteille poussiéreuse, du pain et du fromage, éveillent brusquement en eux une faim brûlante et douloureuse. Les verres s’entrechoquent en un son familier qui suscite en eux le même plaisir: leurs regards se croisent.
La petite fille s’est creusé un nid sur les genoux de l’homme et elle s’endort d’un coup comme un petit animal régi par l’irréfutabilité des besoins naturels. Ils tentent de lancer une conversation mais elle ne rencontre aucun écho et ils se taisent, faisant durer le plaisir intense que leur procurent le vin et le fromage…
Elle se prend à chercher dans sa mémoire un moment de sa vie où l’instant aurait contenu une intensité semblable. Il lui faut remonter loin. Et encore, est-ce vague et brumeux comme une fin d’hiver. Elle est chez elle, c’est à dire dans le lieu ineffable de son enfance, celui auquel ses foyers successifs chercheront à ressembler.
C’est l’hiver et il fait bon. Elle sait que depuis, il n’a jamais fait aussi bon nulle part. Depuis, elle a toujours senti que le froid n’était jamais loin, que la chaleur était éphémère et fragile.
Ces jours-là, il faisait bon ou plutôt, elle n’avait pas conscience de la possibilité du froid. La chaleur était un état permanent et le gaz bleu tressaillait dans le poêle avec un crépitement amusant. Dans la maison, tout était à sa place comme si, alors, les objets avaient une place immuable. Tout était propre aussi, ou plutôt, tout était comme il fallait que tout soit, car enfant, elle n’avait pas conscience de la poussière.
Elle quittait sa chambre avec au fond de la gorge une boule prête à éclater, une boule pleine d’un bonheur sans nom. Elle traversait l’appartement silencieux et ne s’arrêtait qu’au seuil de la chambre où sa mère, le visage baissé vers un ouvrage, semblait toute petite au fond de son fauteuil.
Sa mère ne levait pas les yeux; elle était totalement absorbée par la vie intérieure qui la brûlait et l’enfant comprenait bien que l’ouvrage n’était qu’un alibi. Elle respectait ce mystère et, muette, pleine de cette vision unique, elle retournait dans sa chambre, consciente du nom que portait son bonheur.
Ces jours-là, le bonheur n’était pas nimbé de tristesse. Il était la référence de tous les bonheurs futurs, et la cause de la tristesse qui les entacherait.
Déjà la main de son mari se pose sur la sienne et sa voix s’élève, brisant la cloison fragile qui l’isolait… la distance au prochain village… la voiture… le garage… l’été qui se termine… Leurs hôtes l’écoutent. L’homme sans un mot, la femme en répondant aux questions par de brefs roucoulements rauques: garage, téléphone, voisin, proximité, nuit, matin…
Elle lui jette un regard noir. Qu’importait le lendemain ? Elle allait enfin comprendre quelque chose…

Ils traversent un long hall d’entrée où des ancêtres nappés dans la poussière les regardent passer avec indifférence. L’homme pousse une porte vitrée: c’est l’office. Un buffet, un portemanteau, la vision fugitive d’une cuisine derrière une porte entrebâillée. La porte vitrée claque derrière eux et le silence perd sa qualité profonde et prometteuse d’oubli: il redevient intimidant.
Ils prennent derrière l’homme un escalier de pierre qui monte à l’étage. A mi-hauteur il tourne en un brusque virage et ils aperçoivent en bas la frimousse de la petite fille qui apparaît et se cache aussitôt.
L’homme s’engage dans un couloir, ils le suivent après avoir hésité. Cela les fait penser à ces vieux films qu’ils ont vu enfants, cette demeure sombre, cet hôte silencieux, cette enfilade de portes derrière chacune desquelles on imagine les épouses pendues.
L’homme ouvre une porte et tourne un commutateur. La lumière électrique jaillit dans une grande chambre qui, semblable à la chambre reconstituée d’un musée des arts et des traditions populaires, renferme les meubles et les objets d’une vie passée avec ce qu’il faut de naturel pour faire croire que ses habitants l’ont quittée une minute auparavant. Ainsi, le lit protégé sous un dais, la coiffeuse où traînent les objets usuels de la toilette au milieu du siècle dernier, la cheminée où le sourire ironique des portraits de famille attire le regard; ainsi, les tissus tendus, posés, accrochés, pleins d’une poussière authentique et d’une odeur indescriptible de temps arrêté, nuancé par le parfum fugace d’un sachet de lavande qui a survécu à l’usure.
Leur hôte disparaît dans le couloir obscur, happé dans le silence de la grande maison. Ils restent un instant immobiles, inquiets à l’idée de passer la nuit dans ce cimetière des choses, plein encore de vies depuis longtemps terminées et dont les fantômes se sont emparés. Puis, l’homme se reprend. Il a horreur de l’irrationnel et les pensées qui flottent en eux à cet instant ne le sont que trop.
– Et bien… On va faire avec, n’est-ce pas ?
Elle tremble – de froid, de fatigue, de peur ? – et ne répond pas. Pendant quelques minutes, il joue au touriste qui fait halte à l’hôtel, testant le moelleux du lit, tournant le robinet d’un lavabo caché derrière un paravent, ouvrant l’armoire où des draps de gros coton attendent depuis des décennies de reprendre du service. Tout lui résiste: le lit gémit en se creusant, le robinet crache un filet d’eau jaunasse et l’armoire grince horriblement comme pour annoncer à la maison entière l’indiscrétion des invités.
– On se couche ? On y verra plus clair demain.
Il persiste à être pratique. Elle soulève un des portraits de famille, la photographie pâlie d’une jeune fille des années 20, souriante, fière et sûre de ses merveilleux vingt ans.
On frappe à la porte et leur hôtesse entre, portant des serviettes de toilettes, des robes de chambre fanées et une bouillotte en plastique rouge, totalement anachronique. Elle ressemble à la femme du portrait, elle puise sa vitalité à la même source merveilleuse que la jeune fille.
– C’est votre mère ?
– Grand-mère. Elle est née ici et y a habité jusqu’à l’année dernière. Elle aurait fêté ces jours-ci ses quatre-vingt quinze ans…
– C’était sa chambre ?
Elle est un peu inquiète, le fantôme est trop lourd.
– Non, ça a toujours été une chambre pour les visiteurs.
Un sourire éclaire son visage qui réchauffe le coeur de la femme et attire le regard de l’homme; à nouveau ils ressentent au même instant le même plaisir; ils savent qu’ils partagent ce plaisir; ils en comprennent l’importance.
Leur hôtesse leur explique que sa chambre est au fond du couloir, qu’ils ne doivent pas se gêner pour l’appeler, que la salle de bain est juste en face et que la baignoire fuit… Elle leur souhaite une bonne nuit et sort en refermant la porte derrière elle, laissant sur eux un peu de son sourire.
La femme s’assoit sur le lit et commence à se déshabiller. L’homme va vers elle. Ils se regardent avec surprise sentant monter en eux un désir qu’ils avaient oublié et ne savent plus comment exprimer.

Longtemps qu’elle n’avait pas lu cette exaltation dans ses yeux. Déjà, elle l’entend qui s’endort: sa respiration devient lente et rythmée, plus présente, son corps est agité de légers soubresauts, dernière résistance de la conscience éveillée que l’anéantissement nocturne emporte et broie. Pour elle, le sommeil sera plus difficile à atteindre. L’étreinte amoureuse a été si rapide, si surprenante et gênante sur ce lit bavard que loin de lui apporter le soulagement et la détente, elle l’a replongée dans l’inquiétude en la sortant de la torpeur qui l’habitait depuis qu’ils avaient partagé la collation au coin du feu.
Elle écoute la nuit, cette nuit étrangère, la nuit de cette maison-là. A chaque maison sa nuit et celle-ci est extraordinairement silencieuse. Le lit est dur et se creuse en son milieu les poussant, elle et son mari, à se coller l’un contre l’autre. Il y a un nombre insensé de couvertures et leur poids l’oppresse. Les draps adhèrent à sa peau et c’est comme si l’humidité suintante d’une armoire jamais ouverte la transperçait. Elle en éprouve un dégoût immense et se tourne et se retourne, cherchant une position où le moins de surface possible de ces draps infects toucherait son corps.
Des pleurs d’enfant traversent la nuit, infiniment tristes. Elle avait donc enfin réussi à trouver le sommeil.
– Tu entends ? La petite fille… Tu te souviens ? Les vacances où Camille se réveillait la nuit, tout un été ça a duré… On se levait à tour de rôle.
– Je dors…
– Elle était tellement adorable. Elle sortait de son lit et on la retrouvait toujours dans la cuisine, sur le carrelage froid.
– Chuut…
Son mari grogne. Elle est un peu vexée. Pas moyen de parler. Jamais. En voiture, il dit être concentré sur la route, à table ça lui coupe l’appétit et la nuit, il dort.
Elle se redresse dans son lit, soulève les draps.
– Où tu vas ?
– Je ne sais pas: la petite fille…
Elle entend une porte s’ouvrir. Les cris de l’enfant augmentent comme pour protester contre cette longue attente. Puis c’est le silence. Elle croit discerner un chant très doux mais peut-être le rêve-t-elle?
– Les draps collent… Tu n’as pas chaud ?
– Non.
Elle s’agite et fait tomber le lourd édredon qui opprimait son ventre.
– Arrête de gigoter !
– Je n’arrive pas à dormir.
Il se retourne, l’attire à lui, et se fait très affectueux, comme en souvenir du plaisir qu’elle lui a donné. Elle se laisse caresser, contente. Mais son corps chaud est plus collant encore que les draps humides, sa moiteur l’irrite et son bras pèse lourd sur sa poitrine. Elle se dégage, se détourne. Comme la nuit, parfois, est longue !

Elle ouvre les yeux. L’obscurité est totale: les rideaux datent d’une époque où l’on savait coudre des rideaux épais. Dehors, il fait peut-être jour. Elle perçoit le chuintement monotone de la pluie et imagine la rage de son mari lorsqu’il s’en apercevra. Rien de pire que d’ouvrir le capot d’une voiture en panne sous la pluie. Qu’importe… Elle se sent bien, et c’est une merveilleuse surprise après cette nuit détestable. Son corps est reposé comme il ne l’avait pas été depuis des mois.
Elle avait été réveillée une seconde fois par les pleurs de la petite fille. Mais peut-être n’avait-ce été qu’un rêve ? Elle étend sa main sur la table de nuit, à la recherche de sa montre. Elle ne la trouve pas. Sa main rencontre des objets inconnus, froids et presque obscènes dont elle ne veut rien savoir. Elle se lève, saisit une des robes de chambre de grand-mère et l’approche de son nez pour la sentir: pour rien au monde elle n’enfilerait un vêtement moisi ou sale. Ca va. Le tissu est doux et sent le savon. Elle l’enfile et ouvre la porte qui donne sur le couloir.
Le couloir est clair. C’est donc le jour. Le contraste est brutal et elle est éblouie. Au fond, une porte-fenêtre donne sur un balcon: la lumière vient de là. Et l’air frais aussi, car la porte est ouverte.
Sur le balcon, la pluie l’accueille d’une caresse. Comme l’air est différent, ici, de l’air de la côte où ils ont passé l’été. Tout semble plus humide et plus froid. Elle reconnait le jardin par où ils sont arrivés. Elle voit le mur, le portail métallique, les escaliers, le perron. Elle aperçoit la route, une route normale avec un trafic très raréfié mais un trafic tout de même. Leur voiture doit être plus loin, encore plus fâchée que la veille d’avoir passé la nuit dehors, et sous la pluie.
Soudain la petite fille surgit, nue, semblable à une nymphe des bois, toute en rondeurs et dorée comme une pêche, indifférente à la pluie. Elle lui fait un signe de la main mais la petite fille n’y répond pas. Elle détale dans un fourré.
Elle retourne dans sa chambre pour chercher ses affaires. La petite fille est dans le couloir, vêtue d’une chemise de nuit qui lui rappelle celles de sa propre fille des années auparavant.
– Tu t’es habillée ?
– Hein ?
– Elle est jolie ta chemise de nuit.
L’enfant est contente. Elle se pavane.
– C’est ma tatie qui me l’a donnée. Toi t’en as pas euh ! Tralalalalè-reuh !
– C’est vrai. Et pourquoi tu pleurais cette nuit ?
– Je pleurais pas.
– Je t’ai entendu, tu as fait un mauvais rêve ?
Cette fois la petite fille la regarde avec dédain, hausse les épaules et disparaît dans une chambre dont elle fait claquer la porte.
Elle entend son mari l’appeler et rentre dans leur chambre qui lui parait maintenant très sombre. Elle avance à tâtons vers la fenêtre et ouvre les rideaux. L’homme cligne des yeux.
– Il est tard ?
– Je ne sais pas.
Elle prend sa montre.
– Neuf heures.
– C’est tard. Pourquoi tu ne m’as pas réveillé ?
– Je viens de me lever.
– On doit trouver un garage, réparer la voiture, repartir le plus tôt possible !

Elle aurait voulu l’emmener sur le balcon, qu’il ressente à son tour le mystère du jardin et de la pluie. Peut-être la petite nymphe aurait-elle réapparu pour lui ? Surgie d’un fourré elle lui aurait peut-être fait signe ? Et la pluie douce et tiède l’aurait caressé à son tour.
Mais il est pressé. Sa conscience à peine éveillée l’a entraîné tout entier dans le quotidien et l’idée que la voiture a passé la nuit sous la pluie n’a rien arrangé. Son rationalisme est emporté par un fatalisme tout-puissant. Cela lui arrive dès qu’un événement prend un tour qui le dépasse. Il transforme alors la vie en un cauchemar où les circonstances, liguées contre lui, ne lui laissent plus de choix et exigent qu’il les combatte avec tout l’effort de sa volonté.
Elle déteste ces moments et en a peur. Il est capable des pires folies pour remettre son destin dans le droit chemin.
Ils vont quitter la chambre. Elle photographie tout des yeux afin que plus tard, en souvenir, elle puisse y revenir. Ils remontent le long couloir sans qu’elle ose lui suggérer de sortir sur le balcon.
Ils prennent l’escalier. La porte vitrée de l’office claque et ce bruit la fait sourire. Elle le trouve déjà familier. Leur hôte passe près d’eux, traînant la petite fille nue qui se débat et pleure.
Au salon, un service en porcelaine disposé sur une nappe immaculée semble n’attendre qu’eux. Son mari s’assoit dans ce qui lui parait normal, un petit déjeuner rapidement servi comme dans un de ces hôtels où il s’arrête quand il part en voyage pour affaires. Il pense à sa voiture et à l’enterrement de cette cousine où ils ont décidé de se rendre au dernier moment et à cause duquel ils ont fait ce détour dans leur trajet familier. Cela avait été une erreur: la panne l’avait prouvé et maintenant, ils sont sûrs de rater la cérémonie. Sans doute s’imagine-t-il être puni. Sa règle de vie n’est-elle pas de ne jamais rien faire qui sorte de l’habituel ? L’imprévu lui a toujours porté malchance.
Ils prennent leur petit déjeuner en silence mis à part la remarque qu’il lui fait de se presser. Elle lui oppose une résistance têtue, profitant des tasses aux fleurs si gaies, du pain moelleux et de la vue sur le jardin. En même temps, elle remarque la peinture sale des murs, l’usure des tapisseries des fauteuils, la poussière qui recouvre les bibelots de la cheminée, le sol crasseux. Elle pense à sa propre maison où l’ « à peine usé » est jeté et remplacé sans remords et d’où elle chasse hystériquement la moindre miette tombée au sol.
L’image d’une théière ébréchée héritée de sa grand-mère lui revient à l’esprit: elle l’avait jetée comme on jette une ordure indécente. Le regret l’envahit comme elle revoit la table de sa grand-mère, trente ans auparavant, avec la théière déjà ébréchée et les petits gâteaux secs à la cannelle. Chez elle, rien ne se rattache plus à rien, tout provient de magasins immaculés et sans histoires. Sans histoires.
Leur hôtesse entre. Un garagiste va passer les prendre dans une vingtaine de minutes. C’est un homme charmant et débrouillard. Il arrangerait leur problème. En attendant désiraient-ils un peu de tarte ?
Et voilà qu’elle a une vision: deux petites filles semblables sont sur le seuil du salon, l’une porte une courte robe rose et sourit, l’autre porte un pantalon et semble avoir pleuré peu de temps auparavant. La femme se retourne.
– Alors ça y est ? Tu t’es habillée ?
La petite fille en pantalon baisse la tête.
Le couple les regarde, surpris de l’apparition double, fasciné par la ressemblance totale des deux enfants qui sont comme deux répliques miniatures de leur mère. « Pourquoi tu as pleuré ? » demande la femme, et elle pense: « Laquelle est celle du jardin? «
– Solange refuse de s’habiller, c’est tous les jours la guerre ! Elle est trop grande maintenant pour rester toute nue.
– Elles ont quel âge ?
– Trois ans. Et dans quelques jours, c’est l’école. Elles vont quitter la maison pour la première fois. Quand je dis qu’elles sont à moitié sauvages !
Son mari est lui aussi subjugué par la grâce étrange des deux nymphettes. Il tend la main vers les petites filles.
– Un tour de cheval sur mes genoux ?
Solange secoue la tête, dédaignant l’étranger mais sa soeur en robe rose approche timidement et se laisse secouer sur les genoux de l’homme avec un sérieux inné de femme coquette. Solange en est quitte pour l’envier de loin.
La maîtresse de maison sort et revient rapidement avec une tarte aux abricots.
– Vous en prenez ?
Elle n’ose pas, c’est trop beau. Alors, la femme entaille sans pitié le magnifique disque et pose deux parts parfaites sur des petites assiettes.
Elle prend une part et commence à manger lentement: la pâte très sucrée fond dans sa bouche et les fruits un peu acides lui font faire une grimace de plaisir.
– Maman, c’est la reine des tartes.
La plus sauvage des deux soeurs s’est approchée, intéressée. Elle a refusé son tour de manège mais ne peut résister à la tarte. Elle grimpe sur les genoux de la femme et croque dans sa part, y laissant l’empreinte de ses minuscules dents.
Dehors, la pluie a cessé. Les pins secouent leurs ramures alourdies par l’eau. L’homme et la femme se sentent bien. Chacun a sa petite sur les genoux et ils dégustent la tarte avec le sentiment d’accomplir un office divin.
La dépanneuse s’arrête sur le sentier gravillonné qui mène au perron.




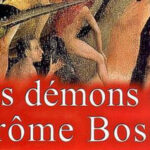


En feuilletant de vieux carnets où je note et je dessine toutes sortes de choses j avais écrit votre nom
En parcourant votre site que j ai beaucoup apprécié j ai aussi lu cette nouvelle. Toutes les scènes successives, on arrive à voir les objets à entendre la pluie à sentir cette nuit sans sommeil
Merci