Etat des lieux, mars 2021
Etat des lieux, ce 15 mars 2021.
J’ai bien regardé Paris aujourd’hui. Entre deux averses, et c’était une ville calme, si calme. En moi bouillonnaient tant de désirs, de parler, rencontrer, échanger, regarder, voyager, mais je ne retrouvais rien de tout cela dans la ville. Le printemps naissant m’a semblé timide, les verts délicats des premières feuilles des arbustes, les forsythias jaunes et les prunus roses – dans les squares municipaux et les jardinets devant les immeubles 1970 – timides et sages, domptés par le regain de froid. Les bourgeons des marronniers, pubescents, prêts à jaillir, mais comme retenus par la peur face au ciel plein de grêle, de giboulées, de menaces. Les parisiens cachés derrière leurs masques n’avaient l’air ni joyeux ni tristes, mais résignés, fatigués. Ils marchaient lentement en jetant des coups d’oeil furtifs aux vitrines des cafés et des brasseries où s’empilent les chaises en osier et les tables. Sur les vitres, la trace d’un plat du jour écrite à la craie liquide il y a quelques mois. La ville somnole un peu; les bus passent en klaxonnant les cyclistes qui sursautent, éjectés de leurs rêveries où ils se voyaient réaliser leurs envies impossibles, les étudiants parlent à mi-voix, on fait la queue devant les boulangeries, on est patients et lents jusqu’à ce que parfois l’agressivité jaillisse, on se fait alors insulter pour un rien.
Cette année le printemps ne rime pas avec libération. Il rime avec patience, ennui, écoeurement. C’est une drôle d’expérience, mais on ne la trouve pas drôle, seulement interminable. Il faut seulement travailler, ou attendre que le travail redevienne possible, il faut rester chez soi, hiberner, encore, calmement, si calmement. On se dit entre soi qu’on n’en peux plus, mais on peut toujours. L’expérience n’est qu’éprouvante, elle n’est pas extraordinaire, ni violente, ni mortelle. Pas de bombes dans le ciel, pas de peste qui ferait tomber raides les passants sur les trottoirs comme dans les films d’anticipation. Non, tout est invisible, la menace, le virus, les désirs, les colères. On obéit, on sait pourquoi, on ne comprend pourtant pas, on a honte de se plaindre, et au jour le jour, on mange un pain de plus, on regarde un film de plus, on remue ses bras face à l’écran pour s’étirer, puis on prend le métro une fois encore, on se meut, calmement, en rêvant de fuites, de fêtes, d’ailleurs, et de refermer la parenthèse.
Je suis tombée, plus tard, rentrée chez moi avant l’heure fatidique, sur un spleen. Pas de Baudelaire cette fois, mais un de ses contemporains, Jules Laforgue.
Le voici:
Tout m’ennuie aujourd’hui. J’écarte mon rideau.
En haut ciel gris rayé d’une éternelle pluie.
En bas la rue où dans une brume de suie
Des ombres vont, glissant parmi les flaques d’eau.
Je regarde sans voir fouillant mon vieux cerveau,
Et machinalement sur la vitre ternie
Je fais du bout du doigt de la calligraphie.
Bah! sortons, je verrai peut-être du nouveau.
Pas de livres parus. Passants bêtes. Personne.
Des fiacres, de la boue, et l’averse toujours…
Puis le soir et le gaz et je rentre à pas lourds…
Je mange, et bâille, et lis, rien ne me passionne…
Bah ! Couchons-nous. – Minuit. Une heure. Ah! chacun dort !
Seul je ne puis dormir et je m’ennuie encor.
Jules Laforgue, SPLEEN (Le Sanglot de la terre)




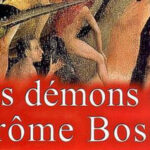


Merci pour ce beau texte, Alexandra.
Il y a aussi les jours où la pluie provoque malgré tout le sourire. Moi qui suis de mars, j’ai peut-être cela dans le sang, de savoir entendre un crépitement joyeux dans les gouttes qui tombent, comme une rythmique musicale, une invitation à slalomer autant que possible entre les gouttes, à s’en moquer un peu, à se rappeler qu’après tout, il ne s’agit que d’un peu de pluie. Ces jours-là, quand on parvient à entendre cette musique, ces jours-là passent mieux que d’autres. La vie continue plus vite, la tristesse n’est plus aussi proche, mais obligée de se cacher, en embuscade.
précisément magnifique, merci